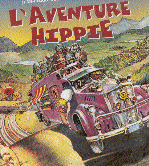

Retour à la case envol… On ouvre L’Aventure Hippie, le livre de Jean-Pierre Bouyxou et Pierre Delannoy et, dès les premières pages, les couleurs vous sautent au visage : bleu marine, rouge vif, rose strident, jaune canari, orange sanguine, vert pomme, coloris acides, forcément acides… Pour bien mesurer la délivrance que ce fut, cette explosion de couleurs, ces juxtapositions audacieuses qui accompagnaient les multiples figures de l’amour libre, le mélange des genres, le droit à la paresse, le tutoiement généralisé, le méli-mélo des formes en expansion (que la typographie « dilatée » de l’époque illustre à merveille), il faut avoir connu ce qui avait précédé, un interminable après-guerre strict, morne, gris, discipliné. Au rayon chiffons, c’était le règne du camaïeu, du ton sur ton, l'impérialisme du BCBG, du décent, du convenable, du triste, un temps où l'on portait encore le deuil (longtemps), où les filles, après s'être mariées impérativement en blanc (en général, très tôt, la chasse aux maris ouvrant avant la majorité légale) n’aspiraient plus, la bague au doigt, qu’à revêtir l'uniforme mondain, en version coûteuse pour les nanties, en version uniprix pour les fauchées : sage cardigan, tailleur pour le jour, robe noire pour le soir, souliers, gants et sac assortis. Les fougueuses Lolitas devenaient héroïnes hitchcockiennes en simili pour une vie sans suspense. Car c’était un temps très raisonnable. Dès l’enfance, l'ourlet de la combinaison ne devait pas dépasser la jupe (« Tu cherches une belle-mère ? » entendait-on, sinon, dans la cour de récré). Il fallait surveiller les coutures des bas, laquer les mèches folles, dompter les chevelures à l’aide de barrettes, de bandeaux, d’élastiques. Le poil superflu était traqué. La peau devait être lisse, les cols, amidonnés, la cravate, réglementaire. Les coiffeurs portaient encore des tabliers blancs. Les vêtements du dimanche n’étaient pas faits pour le lundi. Tout devait être en ordre pour la grande parade sociale encadrée par les parents, les patrons, les proviseurs, les curés en soutane, les gendarmes et les flics. Silence dans les rangs.
Il faut avoir connu ce temps, cette docilité inculquée dès le berceau, cette allégeance à la norme, pour comprendre quelle délivrance fut Mai 68 (et les années qui suivirent), quelle ivresse provoqua la fin des contraintes et des révérences obligées. Soudain, on pouvait "répondre", contester, se draper dans un arc-en-ciel, accumuler des haillons bariolés, des bracelets sonores, laisser barbes et tignasses croître en liberté, revêtir de longs manteaux empestant le suint de mouton à la première averse, traîner des baluchons informes, fumer du rêve, rêver d’ailleurs… L’ensemble (rêves fumeux y compris) composait une panoplie qui engageait au voyage ou qui le racontait. Cette mode dépenaillée (aujourd’hui hautement risible mais néanmoins récupérée) donna à une génération entière une allure d’évadés de Cayenne, de portraits anthropométriques, de manouches hirsutes, de tziganes débraillés sans violon et sans toit. Pour accomplir leur transhumance, les romanichels occidentaux s’entassaient dans des bus asthmatiques et prenaient le large. Les communautés poussaient comme des champignons. La voie de l’Orient était libre (la preuve : au passage, on saluait les bouddhas de Bamiyan). Les mirages scintillaient. Lointains? Insaisissables? Qu’importe, on avait la vie devant soi. Allez, roulez, jeunesse…Droit devant. Oh ! Calcutta !
Ce passé tout proche refait surface et nous submerge au fil des pages de L’aventure hippie, histoire narrée avec un entrain contagieux, une érudition confondante et le recul qui creuse les perspectives. Album jouissif, textes denses, iconographie variée (faisant la part belle au cinéma). L’époque est scrutée à la loupe, passée en revue, détaillée, explicitée, depuis la genèse (les Provos d’Amsterdam, les happenings, le Living Theater…) jusqu’à l’atterrissage sans douceur, en passant par le salut aux beatniks défricheurs, l’apothéose du « flower power », les trips à la mode du temps, la naissance d’Actuel, les enfants du Larzac, l’influence de Charlie, la constellation des fanzines, l’appel de la Route, la pornographie comme outil subversif, la pop music, et tant d’autres manifestations de vitalité, d’originalité, de curiosité. Les auteurs remettent aussi les pendules à l’heure. Œuvre utile car – retour du balancier ? besoin d’un bouc émissaire ? - nous sommes aujourd’hui plongés dans un présent qui pue la repentance et le mea culpa comme on a pu le constater avec la récente "affaire Cohn-Bendit", mauvais procès, défense faiblarde. Et plutôt que d’épiloguer sur ce moche post-scriptum, choux gras pour réacs revanchards et patients (la vengeance est un plat qui se mange parfois glacé…), terminons ce survol éclair en évoquant deux vers d’André Breton peints sur le mur d’une chambre, à Katmandou, il y a plus de trente ans : « La poésie se fait dans un lit, comme l’amour/ Et ses draps défaits sont l’aurore des choses ». Mai 68 a été l’aurore d’une génération. Après quoi se sont succédés - dans l’ordre – l'exploitation marchande, l'accusation de ringardise, l’oubli dédaigneux, la nostalgie mortifère (dont le dernier avatar se nomme « bobo », contraction de bourgeois-bohème). Mais le feu couve sous la cendre. Il suffira que le vent se lève